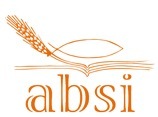Eucharistie : 3 août 2025
18ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C
Dieu nous aide à découvrir le vrai sens de notre vie
Première lecture
Parmi les livres de l’Ancien Testament, on lit très rarement le livre du Qohéleth. En hébreu, le mot « qohéleth » indique une personne n’importe laquelle à l’intérieur d’une communauté, une personne qui réagit – probablement – aux discours de la théologie et de la sagesse officielles[1]. C’est avec ce mot qu’un écrivain se présente, dans la première page de son livre, en écrivant : « Tout est comme un souffle qui s’en va, dit Qohéleth, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien » (Qo 1,2)[2].
Dans cette petite phrase – huit mots en hébreu – cinq fois l’auteur répète le mot « hèvèl », qui signifie souffle, le souffle qui s’en va, une ‘chose’ sans consistance que nous ne pourrons jamais posséder et faire nôtre[3]. Si on traduit cette phrase mot à mot, on pourrait dire : « Futilité de futilité, dit Qohéleth, futilité de futilité, le tout [est] futilité ».
Et dans la petite section du chapitre deux que la liturgie nous propose ce matin, le mot « hèvèl » va revenir encore deux fois (vv. 21 et 23). Dans ces versets, Qohéleth nous présente le cas d’une personne qui s’engage, intensément, dans sa vie, « un humain qui a fatigué – dans son travail – avec sagesse, connaissance et succès ». Et pourtant… il doit laisser tout ça en héritage « à un humain qui n’a pas fatigué pour cela » (v. 21). Après ce constat d’un fait qui se vérifiait fréquemment dans les hautes classes sociales au troisième siècle – donc au temps de notre auteur[4] – et qui se vérifie aussi aujourd’hui, Qohéleth exprime son jugement : cela aussi est « hèvèl », comme un souffle sans lendemain, et c’est « une injustice, grande ! ».
En poursuivant sa page, notre auteur ne peut que revenir sur le terme « fatigue » (« ‘‘âmâl » en hébreu) et s’interroger : « que reste-t-il pour un humain de toute la fatigue et de tout l’effort personnel, [la fatigue] avec laquelle il fatigue son cœur sous le soleil ? » (v. 22). En effet, les jours d’une personne qui a fatigué – dans son travail – avec sagesse et connaissance « ne sont que souffrances, et son occupation n’est qu’affliction ». La vie, c’est vrai, permet aussi à l’individu de « goûter le fruit de sa fatigue ». Et sur ce « don qui vient de la main de Dieu », notre auteur parlera en poursuivant son livre (2,24-26)[5]. Mais, dans la page de ce matin, Qohéleth insiste sur les souffrances de la vie : « Oui, tous ses jours ne sont que souffrances, et son occupation n’est qu’affliction ; même la nuit, son cœur est sans repos » (v. 23). Écoutons ce cri de désespoir, un cri qui parfois peut jaillir aussi de notre cœur.
Lecture du livre du Qohéleth (1,2 et 2,21-23)
12 Tout est comme un souffle qui s’en va, dit Qohéleth, rien ne sert à rien, rien ne mène à rien.
221 Oui, il y a un humain qui a fatigué – dans son travail – avec sagesse, connaissance et succès : et voilà que sa part sera donnée à un humain qui n’a pas fatigué pour cela. Cela aussi est comme un souffle sans lendemain, et une injustice, grande !
22 Oui, que reste-t-il pour un humain de toute la fatigue et de tout l’effort personnel, [la fatigue] avec laquelle il fatigue son cœur sous le soleil ? 23 Oui, tous ses jours ne sont que souffrances, et son occupation n’est qu’affliction ; même la nuit, son cœur est sans repos. Cela aussi est comme un souffle sans lendemain.
Parole du Seigneur.
Psaume
Un peu comme la page du Qohéleth, le psaume 90 est une lamentation sur la condition de tout être humain. Mais, différemment du Qohéleth, le poète du psaume adresse sa lamentation à Dieu. Aujourd’hui, de ce psaume nous allons lire seulement quatre strophes.
La première (vv. 3-4) insiste sur la condition mortelle des humains. C’est ainsi que le poète dit à Dieu : « Tu fais retourner les humains à la poussière, tu leur dis : Retournez [à la terre], fils et filles de l’humain terrestre » (v. 3). Et ces mots, avec le double emploi – tragique – du verbe ‘retourner’[6], sont une reprise du livre de la Genèse. Dans cet ancien récit, à l’homme qui a désobéi à Dieu, Dieu dit : « A la sueur de ton visage tu mangeras du pain jusqu’à ce que tu retournes à la terre, car de la terre tu as été pris ; oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras » (Gen 3,19). Et la strophe souligne la brièveté de notre vie humaine : comparée à l’éternité de Dieu, même une vie très longue, même un millénaire ne sont rien, « comme la journée d’hier, déjà passée, ou comme une heure de la nuit ».
Dans la deuxième strophe de notre psaume (vv. 5-6), la mort n’est pas seulement la destinée de tous les humains, elle est présentée comme le fruit de l’intervention personnelle de Dieu. Le poète écrit : « Tu les emportes » (v. 5). La mort est comme une inondation ou une tempête qui déracine tout, d’un moment à l’autre[7]. La vie est comme un rêve[8], un rêve joli mais inconsistant. Et le poète explique cette situation la comparant avec celle de l’herbe : l’herbe fleurit et se renouvelle[9] le matin, puis – le même jour – elle se fane et elle est coupée[10].
Dans la troisième strophe (vv. 12-13), le poète se comporte un peu comme le Qohéleth qui lançait une interrogation sans réponse (Qo 2, 22). En effet, devant la faiblesse, la solitude et l’abandon vécus par les humains, le poète dit à Dieu : « Reviens, Yahvéh ! Jusqu’à quand…? ». Mais, en même temps, du cœur du poète jaillit la confiance : Dieu peut nous remplir de sagesse ; Dieu, Dieu seul, peut nous apprendre à découvrir le sens de nos jours. Et la strophe se termine avec cette requête à Dieu : « Aie compassion de tes serviteurs ! »
La dernière strophe (vv. 14.17ab) revient sur le mot « matin ». Dans la deuxième strophe, ce terme présentait l’ambiguïté de la vie humaine : un commencement nouveau mais sans aucune durée. Au contraire, dans la strophe finale, le matin – grâce à l’intervention de Dieu, grâce à son amour – ouvre une vie, littéralement « tous nos jours », à la joie : « Rassasie-nous de ton amour au matin, et nous passerons tous nos jours dans la joie et les chants ».
Et, après avoir fait mention de l’amour, le poète évoque aussi la douceur de Dieu. Seulement l’amour et la douceur de Dieu peuvent donner une solidité à notre vie.
En pensant à ce que l’auteur du psaume a vécu, à sa souffrance et à sa solitude, et à l’aide que lui et tellement d’autres personnes ont trouvé en Dieu, nous comprenons bien l’affirmation avec laquelle le psaume commence : « Seigneur, un refuge tu as été pour nous, d’âge en âge » (v. 1). Et cette affirmation, pleine de reconnaissance, sera notre refrain à la fin de chaque strophe.
Psaume 90 (3-4, 5-6, 12-13, 14.17ab)
3 Tu fais retourner les humains à la poussière,
tu leur dis : « Retournez [à la terre], fils et filles de l’humain terrestre ».
4 Oui, mille ans, à tes yeux, sont aussi brefs
comme la journée d’hier, déjà passée, ou comme une heure de la nuit.
Refr. : Seigneur, un refuge tu as été pour nous, d’âge en âge.
5 Tu les emportes [comme un orage] ; ils sont comme un rêve au matin :
ils se renouvellent comme l’herbe :
6 le matin, elle se renouvelle et fleurit,
le soir, elle se fane et elle est coupée.
Refr. : Seigneur, un refuge tu as été pour nous, d’âge en âge.
12 Apprends-nous à bien compter nos jours,
et notre cœur sera rempli de sagesse.
13 Reviens, Yahvéh ! Jusqu’à quand…?
Aie compassion de tes serviteurs !
Refr. : Seigneur, un refuge tu as été pour nous, d’âge en âge.
14 Rassasie-nous de ton amour au matin,
et nous passerons tous nos jours dans la joie et les chants.
17ab Et que soit sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Rends solide, pour nous, l’ouvrage de nos mains !
Refr. : Seigneur, un refuge tu as été pour nous, d’âge en âge.
Deuxième lecture
Il y a une semaine, la lettre aux Colossiens nous parlait de l’intervention surprenante de Dieu. En effet, par le baptême, Dieu nous a mis dans la tombe avec le Christ ; ensemble avec le Christ, il nous a réveillés de la mort, il nous a rendus vivants ensemble avec le Christ (2,12-13).
Et dans la page de ce matin, l’auteur revient d’abord sur ce changement que Dieu a accompli en nous. Il revient sur ce changement pour en tirer les conséquences : « Recherchez donc les réalités d’en haut » (v. 1), « Préoccupez-vous des réalités d’en haut, non de celles de la terre » (v. 2). Ces deux impératifs, qui dominent la première partie de notre page (vv. 1-5), ne suggèrent aucune fuite loin des réalités du monde[11]. Ils demandent une prise de distance par rapport à la vie que les chrétiens vivaient avant de devenir croyants. A cette vie-là, ils sont désormais morts. Et, en terminant cette première partie de la page, l’auteur se fait plus concret : la vie de laquelle les chrétiens doivent prendre les distances est caractérisée par « un mauvais comportement au niveau de la sexualité, l’impureté, les passions, les mauvais désirs et cette soif de posséder, qui est une [forme d’] idolâtrie » (v. 5).
A ces comportements négatifs qu’il faut éviter, notre auteur dédie toute une section dont on lira seulement les derniers versets (vv. 9-11). Le verset 9 s’ouvre avec l’impératif « Ne vous mentez pas les uns aux autres ». En effet, à l’intérieur de la communauté ecclésiale et aussi envers les autres[12], il faut vivre des relations vraies.
Et ces relations sont le signe d’un changement profond : « vous vous êtes dépouillés de votre vieille nature » ou – littéralement – « du vieil homme », donc d’un style de vie dans lequel le mensonge était un comportement habituel. Mais, maintenant, en devenant chrétiens, les Colossiens se sont « revêtus de la nouvelle nature », « un être humain nouveau ». Dans ces versets, notre auteur utilise l’image du ‘vêtement’ : on peut se dépouiller d’un vêtement et en revêtir un autre. Mais cette image n’évoque pas un changement extérieur. Au contraire, il s’agit d’un changement profond, qui commence avec le baptême et qui se poursuit de jour en jour. La lettre aux Colossiens nous le dit en utilisant une forme verbale qui signifie “se renouveler constamment, continuellement”[13]. Et cet engagement constant vise à réaliser en nous, de plus en plus, le projet de Dieu qui a fait l’humain « à son image » (Gen 1,27).
Enfin, la dernière phrase : « Là [où existe l’humanité nouvelle] »[14], toutes les divisions religieuses, sociales et ethniques tombent. Notre lettre évoque d’abord les Grecs et les Juifs, les Juifs qui pratiquent la circoncision, les Grecs qui la refusent. Ces différences n’ont plus de sens. Même l’opposition entre esclaves et hommes libres, une opposition qui caractérisait fortement la civilisation gréco-romaine, tombe. En ouvrant le regard au-delà de l’hébraïsme et de la civilisation gréco-romaine, la lettre mentionne aussi les ‘autres’, les populations qu’on considérait des « barbares » et ceux qu’on considérait encore pires que les barbares, les « scythes »[15]. Mais toutes ces différences et ces oppositions n’ont plus aucun sens : désormais, dans cette humanité nouvelle, « le Christ est tout et en tous »[16]. Écoutons attentivement ce message, qui est très important pour les premiers lecteurs comme pour nous aujourd’hui.
Lecture de la lettre aux Colossiens (3,1-5. 9-11)
Frères, 1 avec le Christ, vous avez été réveillés de la mort. Recherchez donc les réalités d’en haut, là où est le Christ, assis à la droite de Dieu. 2 Préoccupez-vous des réalités d’en haut, non de celles de la terre. 3 Car vous êtes morts, et votre vie a été cachée – et reste cachée – avec le Christ en Dieu.
4 Votre véritable vie, c’est le Christ. Quand il sera manifesté, vous aussi vous serez manifestés avec lui et vous participerez à sa gloire. 5 Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre : un mauvais comportement au niveau de la sexualité, l’impureté, les passions, les mauvais désirs et cette soif de posséder, qui est une [forme d’] idolâtrie.
9 Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de votre vieille nature avec ses habitudes 10 et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature : un être humain nouveau qui, pour accéder à la pleine connaissance, se renouvelle continuellement à l’image que le Créateur lui a donnée.
11 Là [où existe l’humanité nouvelle], il n’y a ni Grec ni Juif, ni circoncision ni incirconcision, barbare, scythe, esclave, homme libre ; mais le Christ est tout et en tous.
Parole du Seigneur.
Alléluia. Alléluia.
Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux ! (Mt 5,3)
Alléluia.
Évangile
L’Évangile de ce matin nous présente d’abord une personne qui demande à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens que notre père nous a laissés » (v. 13). Mais Jésus refuse : au lieu de la division des biens, Jésus préfère la solidarité entre les frères. Derrière la volonté de diviser des biens, il y a – trop fréquemment – la volonté de posséder des biens et des richesses. Et Jésus nous met en garde « de tout amour des richesses ». En effet, « même dans l’abondance, la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens » (v. 15).
Dans la deuxième section de notre page (vv. 16-21), Jésus revient sur l’amour des richesses. Et il le montre à travers un petit récit, celui du riche insensé, un homme qui a des biens et en désire de plus en plus. Il n’a même plus de la place pour amasser ses récoltes, il veut démolir ses greniers et en construire de plus grands. Il veut tout avoir et il pense que, grâce à l’abondance des biens, il sera entièrement réalisé comme homme. Il se dit : « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d’années ; repose-toi, mange, bois et réjouis-toi » (v. 19). Au fond, les richesses et le désir de les posséder enferment cet homme dans la solitude la plus totale. Son seul dialogue est avec soi-même, son « âme », nous dit et nous répète le récit (v. 19).
Mais à la fin du récit, c’est Dieu qui casse la solitude de notre personnage et le questionne. Il le questionne avec une interrogation semblable à celle que le Qohéleth adressait à soi-même (Qo 2,19)[17]. A ce riche qui ne voit que soi-même, Dieu dit : « ton âme te sera demandée[18] ; et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ? » (v. 20). S’interroger sur la mort, sur sa propre mort, ne doit pas faire jaillir en nous le sens de la peur. Le fait de nous interroger sur notre mort doit nous pousser à nous ouvrir à Dieu et à notre prochain, doit nous pousser à donner et à nous donner[19]. C’est ainsi que la peur sera dépassée et qu’on « s’enrichit », nous dit Jésus (v. 21), auprès de Dieu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (12,13-21)
13 Du milieu de la foule, quelqu’un dit à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens que notre père nous a laissés ». 14 Jésus lui dit : « Homme, qui m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre lorsque vous voulez partager vos richesses ? »15 Puis, s’adressant à tous, il leur dit : « Faites attention ! Gardez-vous de tout amour des richesses ; car même dans l’abondance, la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens ».
16 Et il leur dit une parabole : « Un homme riche avait des terres qui apportaient de bonnes récoltes. 17 Et il réfléchissait en lui-même en disant : “Que ferai-je ? Car je n’ai pas de place pour amasser mes récoltes”. 18 Et il dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands : j’y mettrai toute ma récolte et mes richesses 19 et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour beaucoup d’années ; repose-toi, mange, bois et réjouis-toi”. 20 Mais Dieu lui dit : “Insensé ! Cette nuit même ton âme te sera demandée ; et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il ?” 21 Voilà ce qui arrive à celui qui amasse des trésors pour lui-même au lieu de s’enrichir auprès de Dieu ».
Acclamons la Parole de Dieu.
Prière d’ouverture
Dans Ton immense bonté, Seigneur,
montre-moi le chemin de Ta volonté,
et accorde-moi de marcher sous Ton regard.
Seigneur, Toi qui sondes les cœurs,
Tu sais ce dont j’ai besoin.
Tu connais mon aveuglement et mon ignorance,
Tu vois mon infidélité et mon égarement ;
mais Tu connais aussi mon désir,
les douleurs de mon cœur et les souffrances de mon âme.
C’est pourquoi, je T’en supplie, écoute ma prière,
et par Ton Saint Esprit enseigne-moi la voie
sur laquelle je dois marcher[20].
[Archimandrite Sophrony : Moscou, 1896-1993]
Prière des fidèles
* Ce matin, dans le Qohéleth nous avons pu reconnaître un peu nous-mêmes. Car nous sommes un peu comme cet ancien umushingantahe qui – dans sa solitude – s’interrogeait et ne trouvait pas de réponse à ses questions. Aide-nous, Seigneur Dieu, à nous ouvrir à toi. Toi seul tu peux nous aider à découvrir le vrai sens de notre vie et de nos fatigues.
* Parfois, dans les expériences tragiques que nous vivons, nous avons la tentation de penser à toi comme à un Dieu qui châtie, un Dieu de colère, d’indignation, de fureur. Mais le poète du psaume nous aide à dépasser cette mentalité. Il nous parle de l’amour de Dieu, un amour qui peut nous rassasier. Et, en terminant son poème, il évoque « la douceur » de Dieu. Voilà ce qui peut donner une solidité à notre vie et à « l’ouvrage de nos mains ! »
* La lettre aux Colossiens nous a fait comprendre que la résurrection de Jésus n’est pas un événement du passé et sans conséquences. Elle est une réalité aussi dans notre vie personnelle, une réalité qui, jour après jour, change radicalement notre vie. Elle nous fait vivre, à l’intérieur de la communauté ecclésiale et aussi envers les autres, des relations vraies, en faisant tomber toutes les barrières religieuses, sociales et ethniques. Que ce message reste toujours présent dans notre cœur.
* A travers ton récit du riche insensé, tu nous apprends, Jésus notre frère, à voir notre vie d’une façon différente. Vivre en cherchant seulement à jouir de ses biens – grands ou petits – n’a pas de sens ; c’est s’enfermer dans la solitude. Au contraire, la joie c’est se réjouir ensemble de petites choses, de petites joies que la vie nous offre. C’est ainsi que nous pouvons nous enrichir « auprès de Dieu ». Que cet enseignement puisse nous guider dans la vie de chaque jour.
[1] Ainsi J. L’Hour, Qohélet, dans La Bible, Bayard – Médiaspaul, Paris – Montréal, 2001, p. 2905.
[2] Cette traduction reprend – en partie – celle qu’on lit dans La Bible. Ancien Testament, intégrant les livres deutérocanoniques, et Nouveau Testament. Parole de vie, Alliance biblique universelle, Villiers-le-Bel, 2000, p. 908.
[3] L. Mazzinghi, Ho cercato e ho esplorato. Studi sul Qohelet, EDB, Bologna, 2009, p. 124-127. Cf. aussi R. Albert, haebael, soffio, dans E. Jenni – C. Westermann, Dizionario teologico dell’Antico Testamento. Volume I, Marietti, Torino, 1978, col. 405-407.
[4] Cf. L. Schwienhorst-Schönberger, Kohelet, Herder, Freiburg . Basel . Wien, 2004, p. 232.
[5] Cette vision optimiste de la vie, attestée en 2,24, reviendra encore 6 fois dans le Qohéleth. Cf. G. Ravasi, Qohelet. Il libro più originale e “scandaloso” dell’Antico Testamento, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2008, p. 130.
[6] Cf. Ravasi, Il libro dei salmi. Commento e attualizzazione. Vol. II (Salmi 51-100), EDB, Bologna, 2015, p. 884.
[7] Cf. Ravasi, Il libro dei salmi. Commento e attualizzazione. Vol. II (Salmi 51-100), EDB, Bologna, 2015, p. 886.
[8] Le mot hébreu « shénâh » peut signifier “sommeil » ou « rêve ». Cf. L. Alonso Schökel (director), Diccionario bíblico hebreo-español, Editorial Trotta, Madrid, 1994, p. 779b.
[9] Pour le verbe « se renouveler », cf. L. Alonso Schökel (director), Diccionario bíblico hebreo-español, Editorial Trotta, Madrid, 1994, p. 257a, sous la voix « hâlaf ». Une interprétation différente du même verbe dans D. Barthélemy, Critique textuelle de l’Ancien Testament. Tome 4. Psaumes, Academic Press – Vandenhoeck & Ruprecht, Fribourg – Göttingen, 2005, p. 638s.
[10] A la place de la forme verbale « elle est coupée », d’autres traductions ont « elle sèche ». Pour la traduction de cette strophe, cf. L. Alonso Schökel – C. Carniti, I Salmi, vol. 2, Borla, Roma, 1993, p. 250ss.
[11] Cf. J.-N. Aletti, Saint Paul. Épître aux Colossiens. Introduction, traduction et commentaire, Gabalda, Paris, 1993, p. 218.
[12] Cf. M. Ghini, Lettera ai Colossesi. Commento pastorale, EDB, Bologna, 1990, p. 115.
[13] Cf. Aletti, Op. cit., p. 231. Pour la traduction des derniers mots du v. 11, cf. F. Belli, Lettera ai Colossesi. Introduzione, traduzione e commento, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2015, p. 65.
[14] Pour cette signification de l’adverbe grec « hopou », cf. D. Furter, Les Épîtres de Paul aux Colossiens et à Philémon, Edifac, Vaux-sur-Seine, 1987, p. 174.
[15] Pour ces groupes, cf. Ghini, Op. cit., p. 117s.
[16] L’expression grecque « en pâsin » peut être comprise comme un masculin ou un neutre ; on peut donc la traduire par « en tous » ou « en toutes choses ». Mais le contexte suggère de l’interpréter comme un masculin. Cf. F. Belli, Op. cit., p. 65.
[17] Cf. G. Ravasi, Qohelet. Il libro più originale e “scandaloso” dell’Antico Testamento, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 1988, p. 127.
[18] Pour la phrase grecque que Luc exprime avec l’actif « ils demanderont ton âme », cf. F. Bovon, L’Évangile selon saint Luc (9,51-14,35), Labor et fides, Genève, 1996, p. 256.
[19] Cf. F. Bovon, L’Évangile selon saint Luc (9,51-14,35), Labor et fides, Genève, 1996, p. 257.
[20] P. Cuperly, Prières des fils d’Abraham, Cerf, Paris, 1992, p.166.