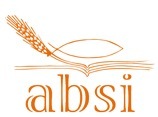Eucharistie: 23 novembre 2025
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’univers
« Il nous a fait passer dans le royaume du Fils de son amour » (Col 1,13)
Première lecture
Les deux livres de Samuel nous présentent le prophète Samuel mais aussi les deux premiers rois d’Israël, Saül et David, deux rois que le prophète a désignés en suivant l’indication donnée par Dieu.
La page de ce matin concerne la royauté de David, quatre décennies qu’on peut situer dès l’an 1010 jusqu’à l’année 970 avant la naissance de Jésus. Le commencement de la royauté de David est présenté comme le fruit de deux interventions : l’une des tribus, l’autre des abashingantahe. Le texte dit : « Et vinrent, toutes les tribus d’Israël » (v. 1), et ensuite « Et vinrent, tous les abashingantahe d’Israël » (v. 3).
Quant aux tribus, elles reconnaissent d’abord l’étroite parenté entre le roi et ses sujets[1] : « nous sommes tes os et ta chair ». Et les tribus reconnaissent aussi que David, déjà au temps de Saül, exerçait la fonction de guide : « c’est toi qui conduisais et qui ramenais Israël ». Mais, à la racine de cette fonction, les tribus voient la volonté de Dieu : « Yahvéh t’avait déjà dit : “C’est toi qui seras le berger d’Israël, mon peuple, c’est toi qui deviendras chef sur Israël” ».
David comme berger et comme chef d’Israël. Ces deux qualifications, l’une à côté de l’autre, ne sont pas identiques. Le mot chef suggère un rôle politique, une autorité : « chef sur Israël » dit le texte hébreu. Quant à la fonction de berger, celui qui doit l’accomplir doit se comporter vraiment comme un berger : le berger est celui qui prend soin du troupeau, celui qui le protège. Être berger d’un peuple signifie donc se mettre au service du peuple[2]. En effet, le peuple n’est pas sa propriété. Il appartient à Dieu et seulement à lui : tu « seras le berger d’Israël, mon peuple ».
Pour ce qui est de l’intervention des abashingantahe, le narrateur parle d’une alliance, une alliance entre David et les abashingantahe de toutes les tribus : il y a là une conception de la royauté comme un contrat[3], le contrat entre David – qui est de la tribu de Juda – avec les abashingantahe de toutes les autres tribus.
Du Deuxième livre de Samuel (5,1-3)
1 Et vinrent, toutes les tribus d’Israël, vers David à Hébron, et lui dirent : « Nous voici, nous sommes tes os et ta chair. 2 Même hier, même avant-hier, quand Saül était roi sur nous, c’est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Et Yahvéh t’avait déjà dit : “C’est toi qui seras le berger d’Israël, mon peuple, c’est toi qui deviendras chef sur Israël” ».
3 Et vinrent, tous les abashingantahe d’Israël, vers le roi à Hébron. Et le roi David conclut avec eux une alliance à Hébron devant Yahvéh, et ils donnèrent l’onction à David comme roi sur Israël.
Parole du Seigneur.
Psaume
Dans la Bible, il y a un groupe de psaumes (Ps 120-134) qui portent, chacun, le titre « Chant des montées ». Ce titre fait référence aux chants que les personnes chantaient en montant – comme pèlerins – vers Jérusalem et vers son temple. Dans certains de ces psaumes, la montée vers le temple est seulement spirituelle : elle est une image pour évoquer la volonté de s’adresser à Dieu, s’adresser à Dieu pour lui exprimer pleine confiance ou pour lui demander de l’aide ou le pardon. Dans d’autres psaumes, comme dans le psaume de ce matin, la montée est réelle, concrète.
Dans la première strophe (vv. 1b-2) de notre psaume, le poète résume, en peu de mots – onze en hébreu -, ce qu’il a vécu dans ce pèlerinage. D’abord la joie quand des personnes l’ont invité à monter au temple et, juste après, l’émotion, très intime, au moment d’arriver à Jérusalem[4].
La deuxième strophe (vv. 3-4) nous met devant les yeux la ville de Jérusalem. En contemplant la ville, l’auteur est frappé par l’harmonie de ses constructions. Les maisons de Jérusalem sont tellement unies entre elles au point de ne constituer qu’un seul tout. De la même manière devraient être unis entre eux aussi ses habitants : ses habitants et aussi les visiteurs.
Ces visiteurs, ces pèlerins, viennent des douze tribus d’Israël. Mais notre poète, au lieu d’évoquer les tribus par le nom des ancêtres, parle des « tribus de Yah » (v. 4). Cette expression, qu’on lit seulement ici dans toute la Bible[5], nous invite à dépasser une conception clanique et ethnique : la caractéristique fondamentale d’une personne n’est pas son appartenance à une ethnie mais… à Yah, au Seigneur, à Dieu.
Dans la troisième strophe (vv. 5-6), le poète continue son éloge de Jérusalem en évoquant la ville comme un centre politique et administratif. Quant à « la maison de David », il ne s’agit pas d’un souvenir plein de nostalgie : en effet, ce souvenir doit pousser les habitants et les pèlerins à s’engager pour la justice et l’unité des tribus.
Enfin, dans le verset 6, le poète insiste sur les mots « Jérusalem » et « paix », et sur le verbe « vivre en tranquillité ». Ces trois termes en hébreux sont presqu’apparentés : ils insistent sur la paix, une paix comprise et demandée comme un don à Dieu.
Quant à nous, nous sommes très loin de Jérusalem et de son temple, et aussi de la paix. Mais pour nous aussi, ce matin la possibilité d’aller à la maison du Seigneur, la possibilité de le rencontrer à l’intérieur de notre communauté, est là. Voilà pourquoi je vous invite à exprimer la joie de cette rencontre, à l’exprimer à la fin de chaque strophe, avec ce refrain qui reprend les mots du premier verset : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Psaume 122 (versets 1b-2. 3-4. 5-6)
1b Quelle joie, quand on m’a dit :
« Nous voulons aller à la maison de Yahvéh ! »
2 Et maintenant nos pieds
se tiennent à tes portes, Jérusalem !
Refr. : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
3 Jérusalem, quelle ville bien construite,
quel ensemble : tout est associé pour elle !
4 C’est là que les tribus – les tribus de Yah – montent en pèlerinage.
Elles viennent célébrer le nom de Yahvéh, selon la règle en Israël.
Refr. : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
5 Car là sont placés des trônes pour la justice,
des trônes pour la maison de David.
6 Demandez la paix pour Jérusalem !
« Qu’ils vivent en tranquillité, ceux qui t’aiment !
Refr. : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Deuxième lecture
C’est peut-être un étroit collaborateur de Paul l’auteur de la Lettre aux Colossiens. Colosses est une ville dans la partie sud-occidentale de la province d’Asie, l’actuelle Turquie. La communauté chrétienne de la ville est confrontée avec des courants différents. Il y a ceux qui se laissent influencer par des prescriptions juives au niveau du calendrier liturgique, des normes alimentaires et de la circoncision. Il y a aussi ceux qui sont plus liés à des conceptions philosophiques païennes sur les puissances célestes[6]. Devant ces problèmes, l’auteur de notre lettre invite la communauté de Colosses à laisser tomber toutes ces considérations religieuses et philosophiques. Le seul point de référence est – et doit être – le Christ ; c’est seulement à travers le Christ que la communauté participe au salut, et elle y participe déjà entièrement[7].
Ce rôle central et unique du Christ est le thème de la page que nous allons lire ce matin.
L’auteur invite les Colossiens à remercier Dieu. Et ça à cause du changement profond vécu par la communauté : le Père « nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume du Fils de son amour[8] » (v. 13). Désormais, nous appartenons – et d’une façon définitive – au Christ[9]. Et ce changement d’appartenance, du pouvoir des ténèbres au royaume du Fils, a comme conséquence le pardon de « nos errements ». C’est le pardon que nous recevons grâce au Fils.
La suite du texte, à partir du verset 15, est un poème, une louange au Christ[10].
La première strophe (vv. 15-18a) chante la position du Christ dans la création. Il est l’image du Dieu invisible : en lui nous pouvons reconnaître les traits de Dieu. Il est « le premier-né au-dessus de toute la création. Car, c’est en lui que Dieu a tout créé » et « tout est créé par lui et pour lui ». La conséquence est évidente : si on accepte d’autres pouvoirs ou d’autres normes, on efface le rôle du Christ. Quant à l’Église, elle n’est pas une réalité autonome par rapport au Christ. En effet, le Christ est sa tête et elle est son corps (v. 18a).
La seconde strophe (vv. 18b-20) revient sur le Christ premier-né, mais cette fois « le premier-né de ceux que Dieu a ressuscités de la mort ». Et la suite du texte exprime la motivation de cette “primogéniture„. A travers ce premier-né, à travers sa mort et sa résurrection, toute l’humanité est réconciliée à lui et naît à nouveau, à une vie nouvelle.
De la lettre aux Colossiens (1,12-20)
12 Remercions avec joie le Père : il vous a fait participer à la condition des saints dans la lumière. 13 Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume du Fils de son amour. 14 Par ce Fils, nous sommes libérés, nos errements sont pardonnés.
15 Le Christ est l’image du Dieu qu’on ne peut voir,
le premier-né au-dessus de toute la création.
16 Car, c’est en lui que Dieu a tout créé
dans les cieux et sur la terre :
les choses qu’on voit et celles qu’on ne voit pas,
les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir.
Tout est créé par lui et pour lui.
17 Le Christ existe avant toute chose,
et c’est en lui que tout se tient :
18 c’est lui qui est la tête du corps, c’est-à-dire de l’Église.
Il est le commencement, le premier-né de ceux que Dieu a ressuscités de la mort,
afin d’être en tout, lui, le premier.
19 Car Dieu, dans toute sa plénitude, s’est réjoui d’habiter totalement dans son Fils,
20 et il a voulu tout réconcilier avec lui,
par son Fils et pour son Fils.
Par le sang que son Fils a versé sur la croix,
Dieu a établi la paix sur la terre et dans les cieux.
Parole du Seigneur.
Alléluia. Alléluia.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. (cf. Marc 11,9b.10a)
Alléluia.
Évangile
Chez les Romains, la crucifixion était le châtiment le plus cruel et dégoûtant[11], réservé à ceux qui n’étaient pas citoyens romains, d’abord les esclaves, ensuite les étrangers. On disait : « Que déjà le mot lui-même “croix„ reste loin non seulement du corps des citoyens romains, mais aussi de leurs pensées, de leurs yeux et de leurs oreilles »[12].
Quant à Jésus, il n’est pas un citoyen romain. Et lorsqu’on l’accuse comme révolutionnaire, lorsqu’on le qualifie comme « le roi des Juifs » (v. 38), la peine de la crucifixion est – pour la civilisation romaine – “normale„. Pour les soldats romains, cette condamnation devient une occasion de dérision : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » (v. 37).
Dans l’Évangile de ce matin, Luc pense à Jésus vraiment comme roi, mais un roi exceptionnel, un roi qui, pour ceux qui le tuent et se moquent de lui, demande à Dieu le pardon : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » (v. 34). Et cette attitude de Jésus est cohérente avec son message : « Priez pour ceux qui vous maltraitent… et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants » (Lc 6,28.35)[13].
La suite du texte nous présente aussi un autre aspect de la royauté de Jésus. Un des deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus reconnaît ses torts et, en même temps, l’innocence de Jésus : « Pour nous, la punition est juste. Oui, nous recevons des choses dignes de ce que nous avons fait ; mais celui-ci n’a rien fait de mal » (v. 41). D’autre part, ce même malfaiteur considère Jésus comme le roi de la fin des temps. Voilà pourquoi il lui dit : « Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu viendras dans ton royaume » (v. 42).
Quant à la réponse de Jésus, elle est surprenante. Le thème de sa royauté, royauté messianique, n’est plus mentionné directement. Jésus se limite à souligner qu’il n’y a pas à attendre une intronisation future[14]. Le changement, changement radical, est déjà là, aujourd’hui : « aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » (v. 43). Et, dans cette parole de Jésus crucifié à un crucifié, la royauté se réalise dans le partage, le compagnonnage dans la souffrance et dans la joie de Dieu. La royauté se concrétise dans l’ « être avec ».
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (23,33-43)
33 Et quand ils arrivèrent au lieu appelé « Crâne », là ils crucifièrent Jésus ainsi que les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. 34 Et Jésus disait : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Quant aux soldats, ils se partagent ses vêtements en tirant au sort. 35 Et le peuple se tenait là, regardant. Les chefs aussi se moquaient de lui en disant : « Il a sauvé les autres. Eh bien, il n’a qu’à se sauver lui-même, s’il est vraiment le Messie, celui que Dieu a choisi ! » 36 Les soldats aussi se jouaient de lui ; s’approchant, ils lui offrent du vinaigre, 37 et disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »
38 Et il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs ».
39 L’un des malfaiteurs crucifiés l’insultait : « N’est-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ». 40 Mais le deuxième, répondant au premier, lui faisait de vifs reproches, en lui disant : « Tu es condamné à mort comme cet homme, et tu ne respectes même pas Dieu ? 41 Pour nous, la punition est juste. Oui, nous recevons des choses dignes de ce que nous avons fait ; mais celui-ci n’a rien fait de mal ». 42 Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu viendras dans ton royaume ». 43 Et Jésus lui dit : « En vérité, je te dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis ».
Acclamons la Parole de Dieu.
Prière d’ouverture
Jésus, tu es notre unique Seigneur,
un berger encore plus humble que David.
Qu’au moins pour ton Église
soit vrai le chant de ta maman :
« que les puissants soient mis à bas de leurs trônes
et que les humbles soient élevés ».
Là où les pauvres seront accueillis,
ton Royaume sera sans fin[15].
[David Maria Turoldo, prêtre et poète, Italie : 1916-1992]
Prière des fidèles
* Le livre de Samuel nous dit que le roi David a conclu une alliance avec « tous les abashingantahe d’Israël ». Et l’histoire d’Israël nous montrera que cette alliance a été très fragile : en effet David était faible et pécheur. Au contraire, l’alliance que le Christ a faite avec nous est efficace et dure pour toujours. Mais nous sommes faibles, Seigneur. Donne-nous la force de rester fidèles, de jour en jour, à l’alliance que tu as faite avec nous.
* Le psaume nous a parlé de la joie des Israélites qui montaient vers Jérusalem, vers le temple, celle qui était ta maison, Seigneur. Et nous, ce matin, nous avons voulu venir ici pour te rencontrer, Seigneur, dans notre communauté. Que cette rencontre avec toi et avec nos sœurs et nos frères puisse donner solidité et joie à notre communauté. C’est ainsi que nous pourrons affronter avec confiance les difficultés et les souffrances qui nous accompagnent dans notre vie.
* La lettre aux Colossiens, pour parler du Christ roi, utilise une expression unique dans le Nouveau Testament : Dieu « nous a fait passer dans le royaume du Fils de son amour ». Seigneur, aide-nous à prendre conscience, de plus en plus, de cette action que tu as accomplie dans notre vie. Et aide-nous à vivre d’une façon cohérente par rapport à cette condition : parce que tu veux que nous aussi, nous vivons comme des filles et des fils de ton amour.
* Jésus notre frère, l’Évangile nous a présenté deux réactions différentes devant ta royauté. En effet les soldats, après t’avoir cloué sur la croix, riaient de toi et disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! ». Au contraire, un des deux malfaiteurs, en reconnaissant ses fautes, te disait : « Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu viendras dans ton royaume ». Que nous puissions, Seigneur Jésus, reconnaître nos fautes et nous confier à toi. Que ces paroles et cette espérance puissent nous accompagner de jour en jour.
[1] Cf. A. Caquot – Ph. De Robert, Les livres de Samuel, Labor et fides, Genève, 1994, p. 400.
[2] Cf. F. Stolz, Das erste und zweite Buch Samuel, TVZ, Zürich, 1981, p. 206.
[3] Cf. A. Caquot – Ph. De Robert, Les livres de Samuel, Labor et fides, Genève, 1994, p. 400.
[4] G. Ravasi, I Salmi, Ancora, Milano, 2011, p. 61.
[5] Cf. J.-L. Vesco, Le psautier de David traduit et commenté, Cerf, Paris, 2006, p. 1183.
[6] Cf. P. Debergé, La constitution du Nouveau Testament. Repères historiques, littéraires et théologiques, dans P. Debergé et J. Nieuviarts (sous la direction de), Guide de lecture du Nouveau Testament, Novalis-Bayard, Paris, 2004, p. 32.
[7] Cf. A. Dettwiler, Épître aux Colossiens, dans Le Nouveau Testament commenté, sous la direction de C. Focant et D. Marguerat, Bayard – Labor et fides, Paris – Genève, 2012, p. 893.
[8] Nous avons ici une tournure unique dans l’épistolaire paulinien. Cf. F. Belli, Lettera ai Colossesi. Introduzione, traduzione e commento, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2015, p. 37.
[9] Cf. R. Fabris, Le lettere di Paolo. Traduzione e commento, vol. 3, Borla, Roma, 1980, p. 79s.
[10] Pour la structure de ce poème, cf. Ibid., p. 82.
[11] Cicéron, Contre Verres 2,5,64,66 : « crudelissimum taeterrimumque supplicium ».
[12] En latin : Nomen ipsum crucis absit non modo a corpore civium Romanorum, sed etiam a cogitatione, oculis, auribus. Ainsi Cicéron, Pro C. Rabirio perduellionis reo 5,16.
[13] Cf. N. Gatti, Il senso del perdono (Lc 23,26-56), dans E. Borghi, La gioia del perdono. Lettura esegetico-ermeneutica del Vangelo secondo Luca. Con la collaborazione di R. Petraglio e N. Gatti, Edizioni Messaggero, Padova, 2012, p. 361.
[14] F. Bovon, L’Évangile selon saint Luc. 19,28-24,53, Labor et fides, Genève, 2009, p. 374.
[15] D. M. Turoldo – G. Ravasi, « Nella tua luce vediamo la luce ». Tempo ordinario, solennità del Signore, feste dei Santi. Commento alle letture liturgiche, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano), 2004, p. 649.